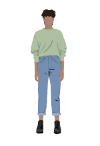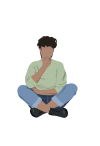NELA - Un parcours de sensibilisation à la lutte contre le racisme
Avec ce parcours de sensibilisation les jeunes déconstruisent la notion de "races humaines". Il ancre l’éducation contre les discriminations et le racisme dans les pratiques des équipes éducatives et défend l’égalité des êtres humains dans la diversité. Il aborde la question des discriminations raciales à travers cinq axes:
- Comprendre les mécanismes de la discrimination
- Comprendre les concepts de stéréotype et préjugé
- Quelles différences entre croire et savoir
- Comprendre les mécanismes du racisme
- Les manifestations du racisme dans nos sociétés
Mécanismes de la discrimination
Stéréotype, préjugés, stigmatisation, comprendre comment naissent et s’articulent les différents mécanismes menant à la discrimination.
N'oublions pas dans les discriminations, le racisme !
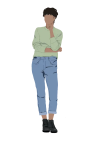
Histoire du concept de racisme et exercices pour comprendre les notions qui l’entourent : catégorisation, hiérarchisation et essentialisation.
Les manifestations du racisme dans nos sociétés
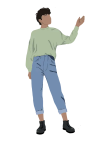
Dates, chiffres clés et personnalités historiques qui luttent contre le racisme : les éléments qui démontrent la manifestations du racisme dans la société et les possibilités d’agir.
Glossaire du parcours de sensibilisation à la lutte contre le racisme
Discrimination • Stéréotype • Préjugé • Catégorisation • Stigmatisation • Classification •Essentialisation • Hierarchisation • Assignation Identitaire • Racisme • Ethnocentrisme • Genre • Espèces • Altérité • Savoir • Croyance • Pensée
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qu'est-ce que c'est ?
Le socle commun rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen.

Ce parcours de sensibilisation à la lutte contre le racisme a été réalisé par le pôle médias-numérique et lutte contre les discriminations des Ceméa, avec le soutien du Musée de l'Homme, de la Fondation Maif pour l'éducation, la DILCRAH et l'ANCT. Avec les ressources des Ceméa, du Musée de l'Homme, et de l'Association Le Crayon.
Les Ceméa participent à la transmission des valeurs de la République en s’engageant notamment auprès des différents acteurs éducatifs et équipes pédagogiques, jeunes et élèves, contre toutes les formes d’expression du racisme. Lutter contre les discriminations, c’est participer à prévenir les violences au sein des écoles et contribuer à un climat scolaire plus apaisé.
Design des personnages NELA : Juliette Bys.